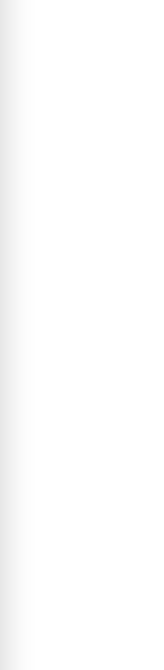avec autrui, de participer à un collectif et d y œuvrer à un but commun. Cela s applique à la petite cité que constitue une entreprise.
De nombreux salariés font la demande de plus d autonomie mais déclarent souffrir d un certain isolement. Pourquoi ?
Nous n avons pas tous la même acception du terme autonomie , ce qui génère des malentendus. Si l on repart de l étymologie, l autonomie, c est le fait de se donner sa propre loi c est radical ! Or, le terme de loi est important : on confond trop souvent l autonomie avec la licence, soit la liberté de pouvoir faire n im- porte quoi. Emmanuel Kant définit l autonomie comme le fait d approuver la loi morale et d agir selon celle-ci. Il s agit donc d obéir à une exigence universelle, au lieu de suivre ses pulsions du moment. Pour être bien vécue, l autonomie suppose donc d agir en responsabilité.
Est-ce qu on ne confond pas autonomie et indépendance ? Quelle est la différence ?
À confondre autonomie et indé- pendance, l entreprise devient un agrégat d individualismes ayant perdu toute ambition de grandir ensemble. C est non seulement un vrai risque stratégique pour l entreprise, mais cela compromet aussi l épanouissement de l individu. Pour le comprendre, reve- nons aux différentes dimensions du travail qu identifie Hannah Arendt dans L humaine condition. Elle distingue le labeur , soit le travail répétitif et sans finalité, de l œuvre , qui produit un résultat tangible (comme l artisanat), et enfin de l ac- tion , qui consiste à commencer quelque chose de nouveau, à initier un changement avec autrui. L action ne peut être que collective : elle n a pas de but prédéterminé, sa finalité naît des interactions avec autrui. C est là l apport inestimable du collectif : l action ne peut émerger sans l effer-
vescence qui agite le groupe lorsque l on se retrouve, que les idées fusent et qui finit par manquer aux individus quand ils sont isolés.
On attend donc d un travail qu il nous rende heureux ?
On a trop longtemps limité la recherche de l épanouissement au travail à une poursuite du bien-être en entreprise, qu on confond avec la simple amélioration des conditions physiques de travail. Simone Weil introduisait pourtant dans les années 1940 la notion essentielle de besoins de l âme au travail, besoins indivi- duels qui sont nourris par le collectif. Ils résonnent de façon étonnamment actuelle : être sollicité dans les prises de décision,
même sur les sujets qui dépassent ses compétences propres ;
pouvoir s exprimer librement ; être encouragé à prendre des risques,
dans un environnement sécurisé, bien sûr.
En lisant Simone Weil, on comprend que la demande d autonomie n est pas forcément synonyme d un éloigne- ment du collectif, bien au contraire. Une entreprise qui tient compte des besoins de l âme des salariés s ap- puie sur la force du collectif de travail pour faire grandir les individus, en les traitant en adultes responsables, dignes de confiance et capables de prendre des initiatives.
Une entreprise qui tient compte des besoins de l âme des salariés s appuie sur la force du collectif de travail pour faire grandir les individus.
I N T E R V I E W
Trois points clés
Ne pas confondre autonomie et indépendance L autonomie traduit un engagement fort du salarié dans l entreprise, quand l indépendance isole les individus les uns des autres.
L autonomie ne va pas sans confiance L entreprise doit valoriser la confiance et revoir ses process pour que l autonomie se réalise.
L autonomie est une expérience de la citoyenneté Parce qu il est sollicité, exprime son opinion et sait prendre des initiatives, le salarié autonome fait l expérience de la citoyenneté.
18
S O
U V
R IR
#1 2023
EQUITY STORIES